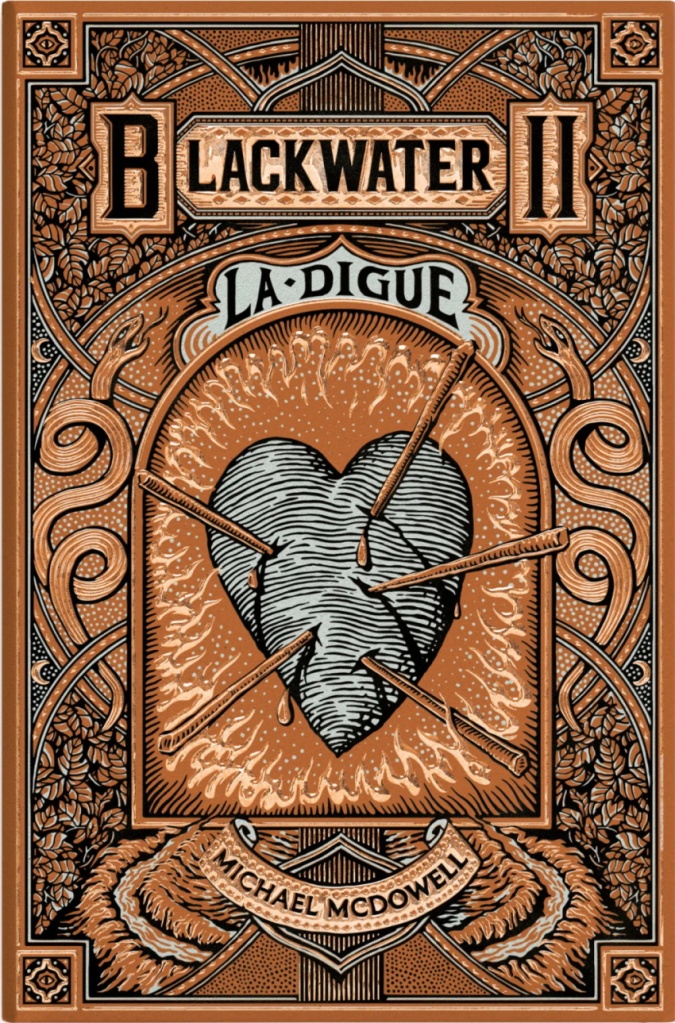Tous les ans, mes collègues et moi-même sommes dans l’obligation de sélectionner plusieurs œuvres, les résumer et donner aux lecteurs envie de les lire pendant l’été. Cette année, après avoir présenté plusieurs nouveautés, j’ai choisi le roman Shibumi. Je me suis dit que c’était une bonne occasion pour vous en parler aussi. Publié en 1979 et réédité chez Gallmeister il y a quelques années, cet ouvrage est considéré comme un classique du roman d’espionnage. La preuve en est que Don Wislow a écrit un préquel en 2011, Satori, imaginant un nouvel épisode de la vie du personnage principal Nicholaï Hel.
Mais qui est Trevanian ?
Le succès du roman est intimement lié à l’aura de mystère qui a longtemps entouré son auteur que l’on connaissait sous le pseudonyme de Trevanian. L’énigme commence dès son premier roman. La Sanction obtient une renommée mondiale mais aucune information sur l’auteur, qui ne prend pas la peine de le promouvoir. Idem pour les suivants. De nombreuses spéculations se créent dans le monde littéraire, ce qui plaît à Trevanian. Il engage même un individu pour assister à des cocktails mondains pour brouiller les pistes. Quand Shibumi sort, il accepte une interview téléphonique mais aucune indication sur son identité. Le Washington Post révèle en 1983 que Trevanian se nomme en réalité Rodney Whitaker, un texan né au Japon et professeur à l’université. Cependant, de nombreuses personnes doutent de la véracité des faits. On le présume mort en 1987 mais il publie un recueil de nouvelles qui dément l’information. A la suite de cette publication, il accepte deux autres interview par fax, confirmant son identité. Même si on sait que Trevanian est bien Rodney Whitaker, très peu de choses ont pu être réunies sur lui. Il meurt en 2005, laissant un voile de mystère derrière lui.
La culture nippone exacerbée
Shibumi est une ode à la culture japonaise qui, d’après Trevanian et son protagoniste, Nicholaï Alexandrovitch Hel, a été dénaturée par la défaite de la Seconde guerre mondiale. Le mot japonais shibumi se réfère à l’esthétique, un sentiment généré par la beauté simple et subtile. Le personnage de Nicholaï va tenter tout au long de sa vie d’y être fidèle. Sa définition très évasive permet de multiples interprétations. Le roman est divisé en six parties, chacune évocant une stratégie utilisée dans le jeu de go (peut être juste une mini parenthèse qui explique ce qu’est le jeu de go ?)
L’intrigue
Nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle se situe l’intrigue mais on sait qu’elle se déroule durant la guerre froide. Une entreprise paragouvernementale nommée la Mother Company contrôle tous les organismes de renseignements occidentaux (CIA, MI6 … etc) pour garder sa mainmise sur le pétrole. Lors d’une fusillade organisée par cette dernière dans un aéroport, l’une des cibles survit. C’est une jeune femme du nom de Hannah Stern. Elle réussit à s’échapper et trouve refuge dans un petit village du pays basque, dans la demeure de Nicholaï Alexandrovitch Hel. Celui-ci est un tueur à gage mondialement connu, réputé pour son efficacité et sa technique particulière, le hoda kurusu (utilisation d’objets ordinaires pour tuer une personne). Hannah Stern va demander à Nicholaï de l’aider dans une entreprise périlleuse : tuer les membres d’une organisation appelée Septembre noir, responsable de la mort de son cousin. Par cette entreprise, elle espère se venger mais aussi honorer la mémoire de son oncle, Asa Stern, grand ami de Nicholaï. Va-t-il accepter, alors qu’il a pris sa retraite depuis deux ans et qu’il est déjà la cible de la Mother Company ?
Mon analyse
Contrairement à la plupart des romans d’espionnage classiques, Trevanian fait le choix de ne pas centrer le sujet de son roman sur le combat entre Hel et la Mother Company. En effet, il consacre 80% de l’ouvrage à l’histoire de Nicholaï. Personnage atypique, c’est certain. D’origine russe mais sans nationalité, né à Shanghai d’une aristocrate ayant fui l’URSS, Nicholaï va être balloté par les évènements qui constituent la « grande histoire ». Il passe de la prise de Shanghai par les japonais au bombardement d’Hiroshima et Nagasaki, puis se retrouve pris entre les Etats-Unis et l’URSS qui contrôlent la ville de Tokyo au lendemain de la guerre. On arrive ensuite dans le pays basque, tiraillé par son envie d’indépendance et son impuissance face à la force de la France et de l’Espagne. De plus, Nicholaï est doté de capacités exceptionnelles, renforcées par une discipline et une détermination de fer. On éprouve à son égard une certaine empathie mais surtout un sentiment de malaise face à cet homme singulier et parfois même « trop » parfait. Il excelle dans absolument tout ce qu’il entreprend, y compris le sexe, qu’il utilise même pour « punir » certaines femmes. Autant dire qu’on repassera pour la figure féministe. Il représente l’idéal oriental, sorte de samouraï des temps modernes, confronté à l’américanisme grandissant dans le monde d’après guerre. Anachronique, certes, mais malgré tout appréciable si on arrive à faire abstraction.
Trevanian offre une critique cinglante des sociétés occidentales, considère les anglais incompétents, les français odieux et arrogants mais surtout, il exècre les américains. Cette société de « marchands », dont les origines constituent la lie de l’ancienne Europe, est malmenée à chaque instant. Elle ne peut rivaliser, selon lui, avec le raffinement de la culture japonaise. Pire, elle ne peut ni l’appréhender, ni la comprendre. Avec talent, il réussit à faire de son héros l’antagonisme total et brillant d’un James Bond fortement diminué (mais tout aussi sexiste rassurez-vous !). Tout ce qui fait partie en général d’un roman d’espionnage durant la guerre froide est détourné, remanié et savamment recréé pour faire de Shibumi une œuvre déroutante et originale. J’ai du relire cet ouvrage découvert il y a quelques années et j’y ai pris autant de plaisir. Je vous conseille fortement d’en faire de même.
Petite anecdote marrante que je ne savais pas où placer
Une note est glissée dans le roman concernant la technique du hoda kurusu utilisé par Hel. En effet, l’auteur précise qu’il ne donnera pas d’explication précise car certaines idées de ses précédents romans ont été appliquées consciencieusement, notamment le vol réussi d’œuvres d’art dans un musée hautement surveillé de Milan, et qu’il ne veut pas risquer de donner d’autres éléments pouvant permettre le succès d’activités criminelles.
Et d’ailleurs, ça ne vous fait pas penser aux méthodes de combat d’un certain (adoré pour ma part) John Wick ?
Autres critiques : Charybde 27, Tu vas t’abîmer les yeux, Les petites lectures de Maud